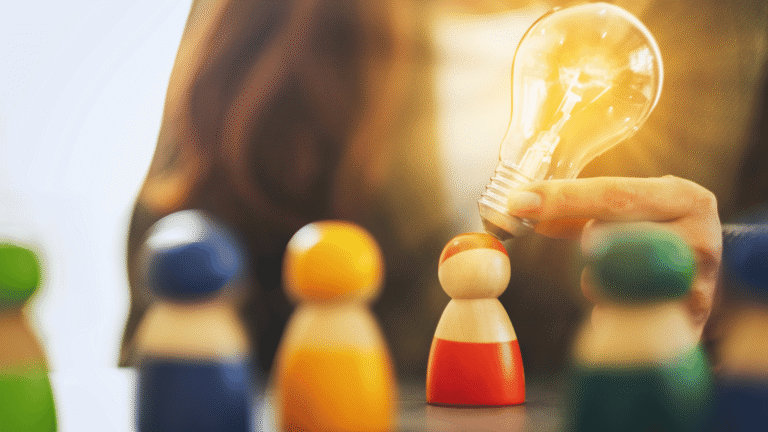De la co-création d'idées à la recherche de solutions ouvertes
Les plateformes d'innovation ouverte et d'idéation permettent de résoudre rapidement un problème ou de générer de nouvelles idées en puisant dans les connaissances externes. Le gain de temps et les opportunités inédites qu'offre cette approche séduisent de plus en plus d'entreprises. Inventées dans les années 2000 et popularisées au début des années 2010, ces plateformes connaissent depuis une croissance constante. Aujourd'hui, 95% des organisations utilisent déjà l'innovation ouverteet plus de la moitié l'intègrent dans la plupart de leurs projets. Cette démocratisation se traduit par l'augmentation des défis d'innovation proposés chaque année à des innovateurs externes, ainsi que par le nombre croissant d'acteurs spécialisés.
Par exemple, la plateforme Agoriser revendiqué en 2023 un une communauté mondiale de 10 millions d'innovateurs et plus 300 grandes entreprises clientes. Pour sa part, InnoCentive (qui fait maintenant partie de Wazoku) a franchi en 2025 le cap de la 2 500 défis d'innovation relevésavec plus de 200 000 idées soumises et $60 millions d'euros de récompenses distribuées. La plateforme ideXlab met à profit l'expertise de plus d'un million d'entreprises innovantes et 14 millions d'experts dans le monde.
Les plateformes d'innovation ouverte servent de intermédiaires entre "chercheurs"(entreprises en quête d'innovation) et "résolveurs"(individus, startups, laboratoires fournissant des solutions), en organisant des appels à idées ou des défis de solutions basés sur des questions données, un peu comme des places de marché pour l'innovation. Le plus souvent, il s'agit de mettre en relation une entreprise avec un large vivier de contributeurs non spécialistes (crowdsourcing d'idées), ou à un réseau d'experts de haut niveau (l'approvisionnement en solutions spécialisées).
Certaines plateformes d'innovation ouverte ciblent des communautés spécifiques, telles que les étudiants, les startups ou les experts universitaires. Malgré la diversité de ces modèles, nous pouvons regrouper ces plateformes en deux catégories principales : ceux qui se concentrent sur les l'idéation collaborativeet ceux qui visent à résolution de problèmes avec des experts externes.
Plateformes d'idées : exploiter l'intelligence collective
Plateformes de génération d'idées visent à exploiter "l'intelligence collective" en sollicitant un grand nombre de contributeurs pour générer de nouvelles idées. Certains s'adressent au grand public, dans une logique de crowdsourcing ouvert à tous (Spigit, Agorize, Wazoku, HeroX, etc.), tandis que d'autres se concentrent sur des communautés spécifiques - par exemple, les employés d'une entreprise dans le cadre de l'innovation interne (via des solutions collaboratives telles que les réseaux sociaux d'entreprise). Dans ce dernier cas, des outils tels que Jive ou Microsoft Viva peuvent être utilisés pour canaliser les idées des collaborateurs.
Ces plateformes d'idéation offrent la possibilité de restreindre ou d'élargir le public cible selon les besoins. Par exemple, certaines entreprises font directement appel à leurs consommateurs ou les fans pour trouver des idées afin d'améliorer les produits ou les campagnes. Coca-Cola, Oreo et Patagonia ont organisé ces dernières années de nombreux concours d'idées de ce type, où la meilleure suggestion pouvait déboucher sur un nouveau produit ou une publicité innovante, l'initiateur de l'idée étant récompensé. Plus récemment, LEGO a mis en place une plateforme communautaire (LEGO Ideas) invitant les fans de la marque à proposer de futurs kits - plusieurs créations de fans ont été commercialisées grâce à ce processus collaboratif (une démarche qui s'inscrit dans la stratégie d'innovation ouverte du groupe). Les marques utilisent ces défis d'idéation pour renforcer l'engagement de leur communauté tout en bénéficiant d'un vivier créatif externe.
Plateformes de résolution de problèmes : recherche des meilleurs experts
Contrairement aux défis liés à l'idéation des consommateurs, des "solutions" d'innovation ouverte cherchent à résoudre des problèmes techniques complexes en faisant appel aux meilleurs experts externes. Il s'agit de publier un problème spécifique et de le diffuser de manière ciblée aux personnes susceptibles de le résoudre (scientifiques, ingénieurs, start-up spécialisées, etc.). La plateforme agit comme un intermédiaire en donnant accès à une base de données d'experts, en gérant le projet (questions-réponses, gestion de la proposition) et en offrant souvent à l'entreprise cliente (le "demandeur") la possibilité de rester anonyme pour les résolveurs (afin de protéger sa confidentialité).
Il existe généralement deux types de modèles d'intermédiation pour ces plateformes de solutions :
- Marchés d'expertsCe modèle permet à tout innovateur ou expert de s'inscrire sur la plateforme et d'être informé des nouveaux défis qui correspondent à ses compétences. Des plateformes de longue date telles que InnoCentive et Innoget fonctionnent sur ce principe. Il s'agit d'un modèle relativement simple à mettre en place, mais qui nécessite d'investir dans la notoriété de la marque afin d'attirer suffisamment de membres qualifiés. Les plus grandes communautés d'experts en ligne comptent aujourd'hui plus de 400 000 à 500 000 membres. Par exemple, InnoCentive (InnoCentive@Work) a construit un réseau international de 375 000 résolveurs au cours de sa première décennie d'existence, et son intégration dans Wazoku porte désormais cette base à près d'un demi-million d'experts. De leur côté, les plateformes d'idéation ouvertes peuvent mobiliser encore plus d'utilisateurs potentiels (Agorize revendique 10 millions d'innovateurs inscrits), mais cette audience est moins spécialisée. L'inconvénient du modèle de la "place de marché" réside dans le fait qu'il n'est pas possible d'y accéder. qualifications hétérogènes des participants : il est difficile pour ces plateformes généralistes d'évaluer précisément l'expertise de chaque membre ou d'être polyvalentes dans tous les domaines techniques couverts par les défis.
- Plateformes de recherche d'experts ciblées: une seconde, plus proactifs implique la plate-forme elle-même identifier les experts les plus pertinents sur un sujet donné et les inviter à proposer une solution. Des acteurs comme ideXlab ont développé cette approche en utilisant des techniques de data mining (publications scientifiques, brevets, etc.) pour trouver des profils adéquats, puis en contactant directement ces experts. Dans le même ordre d'idées, la veille technologique et le repérage des solutions telles que StartUs Insights utilisent l'IA pour détecter les start-ups ou les laboratoires à la pointe d'un domaine donné. Ce modèle d'innovation ouverte ciblée est plus complexe à exploiter (il nécessite des capacités avancées d'analyse de données et de mise en réseau), mais présente plusieurs avantages. Il peut être appliqué tout type de sujetmême très spécialisés ou de niche, et il garantit l'accès à l'information et à la formation. pertinence des contributeurs sollicités (puisqu'ils sont présélectionnés pour leurs compétences). En outre, confidentialité est mieux contrôlée : les défis ne sont pas publiés publiquement sur le web mais envoyés directement à des experts identifiés, ce qui évite d'exposer les besoins de l'entreprise aux yeux du public.
Tendances et chiffres clés de l'innovation ouverte
Pour mieux comprendre l'activité récente des plateformes d'innovation ouverte, examinons quelques tendances post-2020 en chiffres.
Croissance soutenue et adoption généralisée de la pratique
Le marché du défi de l'innovation continue de croître rapidement. Comme nous l'avons déjà mentionné, la grande majorité des grandes entreprises intègrent désormais l'innovation ouverte dans leur stratégie. 71% prévoient même d'augmenter leurs investissements dans ce domaine au cours des deux prochaines années. Cette croissance se traduit par une forte augmentation du nombre de défis publiés par rapport au début des années 2010.
De même, le nombre de acteurs impliqués a explosé : les réseaux de résolveurs qui ne comptaient que quelques dizaines de milliers de membres il y a dix ans en comptent aujourd'hui des centaines de milliers. Ce boom n'est pas seulement quantitatifmais aussi géographique et sectorielle. Des centres d'innovation ouverte se sont développés dans le monde entier : par exemple, Londres, Paris et New York accueillent un grand nombre de laboratoires d'innovation ouverte d'entreprises. Singapour a également lancé un portail national regroupant les défis de l'innovation ouverte (Réseau d'innovation ouverte), qui a permis à des centaines d'entreprises locales d'entrer en contact avec des startups innovantes depuis 2019.
Parallèlement, il y a eu une la multiplication des initiatives publiques ou universitaires adoptent ces modèles (concours d'innovation gouvernementaux, laboratoires ouverts, etc.), contribuant ainsi à l'essor général de l'innovation ouverte.
Plus de défis, souvent à plus petite échelle
Avec la généralisation de l'innovation ouverte dans les entreprises de toutes tailles, nous assistons à une augmentation du nombre d'emplois dans le secteur de la santé. la prolifération de défis à plus petite échelle aux côtés des grands concours offrant de grandes cagnottes. En 2013, les jeux-concours offrant des récompenses financières ont eu une part de marché de prix moyen d'environ 20 000 euroset ceux de moins de 10 000 euros représentaient déjà près de la moitié de tous les projets de plateforme (alors qu'ils étaient pratiquement inexistants deux ans plus tôt). Cette tendance s'est accélérée après 2020 : de plus en plus de défis ciblent désormais des questions spécifiques avec des récompenses modestes. Aujourd'hui, la plupart des concours d'innovation lancés par les entreprises offrent des prix allant de de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'eurosEn rendant l'outil accessible aux PME ayant des besoins particuliers, il est possible d'améliorer la qualité de l'information. des budgets d'innovation limités. Par exemple, le fabricant d'outils Husqvarna a récemment lancé un défi sur la protection de la biodiversité (en particulier, la lutte contre les espèces envahissantes), avec un objectif d'un million d'euros. Prix de 5 000 euros pour le vainqueur. De même, la chaîne de magasins britannique Waitrose sollicite régulièrement des idées par l'intermédiaire de Wazoku sur des sujets tels que l'amélioration du service ou de l'emballage, en offrant des récompenses symboliques.
A l'autre bout du spectre, "grand défi"Les concours de ce type n'ont pas disparu : au contraire, ils sont souvent organisés par des acteurs publics ou industriels pour s'attaquer à des problèmes mondiaux et sont assortis de prix très importants. Par exemple, le concours Édition 2025 du Prix mondial de l'innovation dans le domaine de l'eau (dirigée par l'Autorité saoudienne de l'eau) propose $1,8 million en récompensant et en finançant des solutions pilotes pour soutenir l'accès durable à l'eau. De même, le Département de l'énergie des États-Unis a lancé une $5.1 millions concours pour le recyclage des éoliennes en fin de vie. Entre ces deux extrêmes, nous trouvons des défis plus "classiques" lancés par de grandes entreprises, qui offrent généralement des prix compris entre 1,5 et 2 000 euros. 10 000 € et 100 000en fonction de la complexité du problème et de la valeur attendue de la solution. Les baisse du montant moyen des prix observée ces dernières années s'explique par l'augmentation massive des défis "standard" à petite échellemais cela n'a pas empêché des initiatives beaucoup plus importantes d'être proposées en parallèle. Cette évolution reflète une une intégration plus systématique de l'innovation ouverte dans les processus de R&D : les entreprises l'utilisent désormais non seulement pour la recherche et le développement, mais aussi pour la gestion des ressources humaines. les grands projets de rupturemais aussi de résoudre les problèmes de problèmes à plus petite échelle ou d'explorer des opportunités adjacentes à moindre coût.
Un délai moyen de résolution d'environ trois mois
Le durée moyenne d'un défi d'innovation ouverte reste d'environ 90 jours (trois mois) pour la phase de soumission de la solution, un chiffre qui est resté relativement stable par rapport à la décennie précédente. Cependant, il existe une grande variabilité en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise. nature des défis et la philosophie des plateformes. Certaines plateformes favorisent délais courts D'autres prévoient une durée de 6 à 8 semaines pour maintenir l'élan et répondre à des besoins qui évoluent rapidement (c'est souvent le cas pour les concours d'idées ou les hackathons axés sur le numérique). D'autres prévoient périodes plus longuesLa durée de l'intervention peut aller jusqu'à 5 ou 6 mois, en particulier lorsque le problème nécessite une intervention de la part de l'autorité compétente. R&D approfondie ou des prototypes complexes - c'est par exemple le cas de l'approche utilisée par Innogetqui structure ses appels sur de longues durées. Cette différence s'explique aussi en partie par le fait que le nature des sujets: demande à ce que transfert de technologie ciblé (par exemple, trouver un composé chimique alternatif pour une formulation donnée) ont tendance à être résolus plus rapidement, car les experts capables de répondre sont peu nombreux et facilement identifiables. En revanche, les défis d'idéation générale (par exemple, imaginer de nouvelles applications pour un matériau) bénéficient souvent d'un délai plus long pour recueillir une grande variété d'idées.
Il est également important de prendre en compte les sélection et évaluation le temps suivant la date limite de soumission : pour un grand défi international, l'organisateur peut prendre plusieurs semaines pour analyser les propositions en interne, tester les preuves de concept et sélectionner le gagnant. Au total, le cycle de vie complet d'un défi (du lancement à l'annonce des résultats) s'étend souvent sur 4 à 6 mois. Par exemple, les défis d'innovation ouverte organisés à Singapour en 2024 comprenaient une phase d'appel à solutions de trois mois, suivie de phases de prototypage et de démonstration, l'ensemble du processus s'étalant sur environ cinq mois avant la sélection finale. Malgré ces délais, l'innovation ouverte permet aux entreprises d'aboutir à des solutions en quelques mois, alors que le développement interne traditionnel aurait souvent pris beaucoup plus de temps.
Formes de collaboration : la recherche sous contrat en tête de liste des partenariats
Enfin, jetons un coup d'œil à la rubrique nature des collaborations qui découlent de ces plateformes d'innovation ouverte. Poser une question ou un défi n'est qu'une étape : une fois la solution trouvée ou l'idée retenue, comment l'entreprise "demandeuse" exploite-t-elle concrètement cette innovation externe ? Le choix de la méthode et des modalités varie en fonction de l'activité de l'entreprise. nature du projet et de la maturité de la solution fournie, allant d'une simple idée théorique à une technologie éprouvée nécessitant un accord de licence.
Selon les données disponibles, le format le plus courant sur les plateformes d'innovation ouverte reste le suivant recherche contractuelle. Dans plus de la moitié des cas, l'entreprise conclura un accord avec le fournisseur de solutions pour financer le développement ou l'adaptation de sa technologie à une application spécifique. Cette "R&D contractuelle"Ce modèle est particulièrement intéressant car il offre un effet de levier optimal en permettant à l'entreprise de capitaliser sur les résultats de la recherche existante tout en bénéficiant d'un soutien financier de la part de l'État. acquisition (souvent exclusifs) droits à la solution à un coût raisonnable par rapport à un développement en interne. Concrètement, cela peut prendre la forme d'un contrat de service de R&D, d'une subvention de maturation versée à un laboratoire, ou encore d'une bourse de recherche. preuve de concept financé par une start-up.
Le deuxième format courant est la technologie octroi de licences. L'entreprise négocie un accord de licence avec la personne qui a résolu le problème (ou son employeur). Par exemple, une entreprise qui a trouvé un nouveau matériau innovant grâce à un défi peut signer un accord de licence avec le laboratoire qui l'a inventé pour utiliser ce matériau dans ses propres produits. Viennent ensuite des projets plus avancés codéveloppement et partenariats (accords dans le cadre desquels l'entreprise et l'expert développent conjointement un produit, en partageant les risques et la propriété intellectuelle). Ce format correspond souvent à des projets plus ambitieux ou stratégiques et implique une relation à long terme.
Depuis 2020, on observe également une augmentation des modèles d'incubation et d'accélération liée à l'innovation ouverte. Plutôt que de simples contrats ponctuels, les grands groupes intègrent désormais des innovateurs externes dans leurs projets. programmes d'accélération ou client potentiel Les projets. Dans ce modèle, la "récompense" pour la startup gagnante n'est pas seulement financière - elle peut prendre la forme d'une "bourse d'études". contrat de fournisseur ou un projet pilote déployé au sein de l'entreprise, et parfois même participation au capital. Par exemple, le Odyssée urbaine par Icade ou le programme Appel à projets LVMH offre aux jeunes entreprises sélectionnées la possibilité de devenir des fournisseurs du groupe ou de bénéficier de son infrastructure pour développer leur activité.
Conclusion
En l'espace d'une décennie, la gamme de plates-formes d'innovation ouverte s'est solidement établie et la pratique est devenue courante dans de nombreuses organisations. Le nombre de transactions et de collaborations résultant de ces plateformes a augmenté de façon exponentielle, et l'innovation ouverte est désormais utilisée à la fois pour des projets de recherche et des projets de développement. projets technologiques à grande échelle et des problèmes à plus petite échelle au sein des entreprises. Des leaders mondiaux tels que la NASA, General Electric et L'Oréal l'utilisent, de même que des entreprises de taille moyenne dans divers secteurs. L'approche a fait ses preuves en termes de vitesse et diversité des solutions obtenu.
Cela dit, le potentiel de l'innovation ouverte est encore loin d'être pleinement exploité. Certaines industries ou régions traditionnelles commencent à peine à l'adopter, et de nombreuses entreprises expérimentent encore sans en tirer pleinement parti. En voici un exemple, seulement une minorité (22%) des grands groupes qualifient actuellement d'"excellents" les résultats de leurs initiatives d'innovation ouverte - signe qu'il y a encore des défis à relever pour optimiser l'intégration d'idées externes. Accélération interneLa gestion de la propriété intellectuelle et la transformation des idées en résultats concrets sont autant de domaines clés sur lesquels il convient de se concentrer afin de maximiser l'efficacité de l'action de l'Union européenne. Le retour sur investissement de l'innovation ouverte.
Pourtant, la dynamique est claire : l'innovation ouverte s'impose peu à peu comme un élément essentiel de l'économie européenne. un levier stratégique essentiel pour innover plus rapidement et plus efficacement en s'ouvrant à l'écosystème. Les années à venir pourraient voir une adoption encore plus large (y compris parmi les PME, le secteur public, etc.), à mesure que les communautés de résolveurs s'agrandissent et que de nouvelles formes de collaboration en ligne émergent. Dans le cadre de l'initiative 2023, 75% des grandes entreprises a déclaré que l'innovation ouverte est essentielle pour relever les grands défis auxquels elles sont confrontées. Cette conviction, alimentée par les progrès des plateformes numériques (IA, l'appariement automatisé), suggère que l'innovation ouverte et les plates-formes d'idéation ont encore de beaux jours devant elles. un avenir prometteur-au profit de tous les innovateurs, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation.